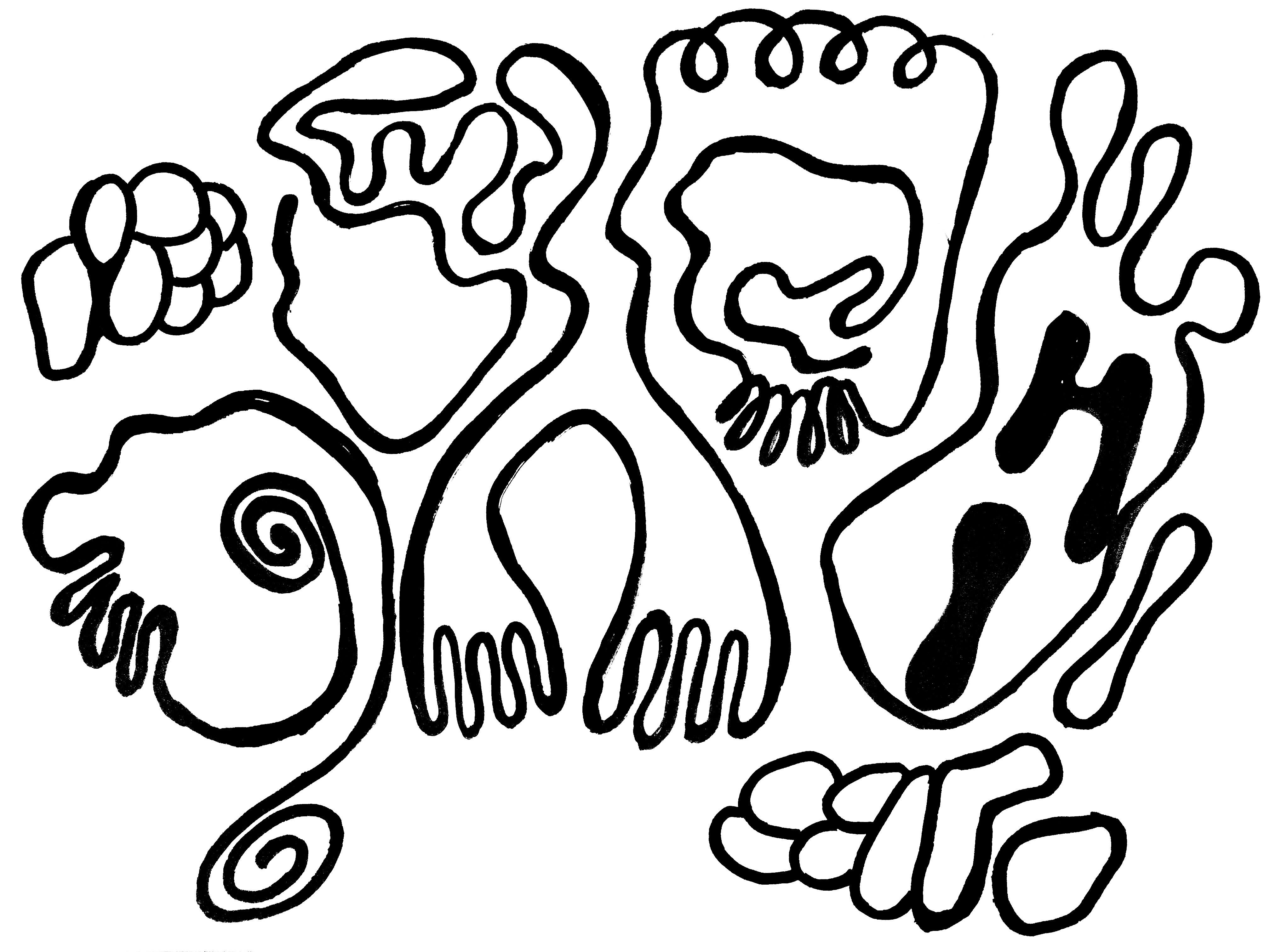
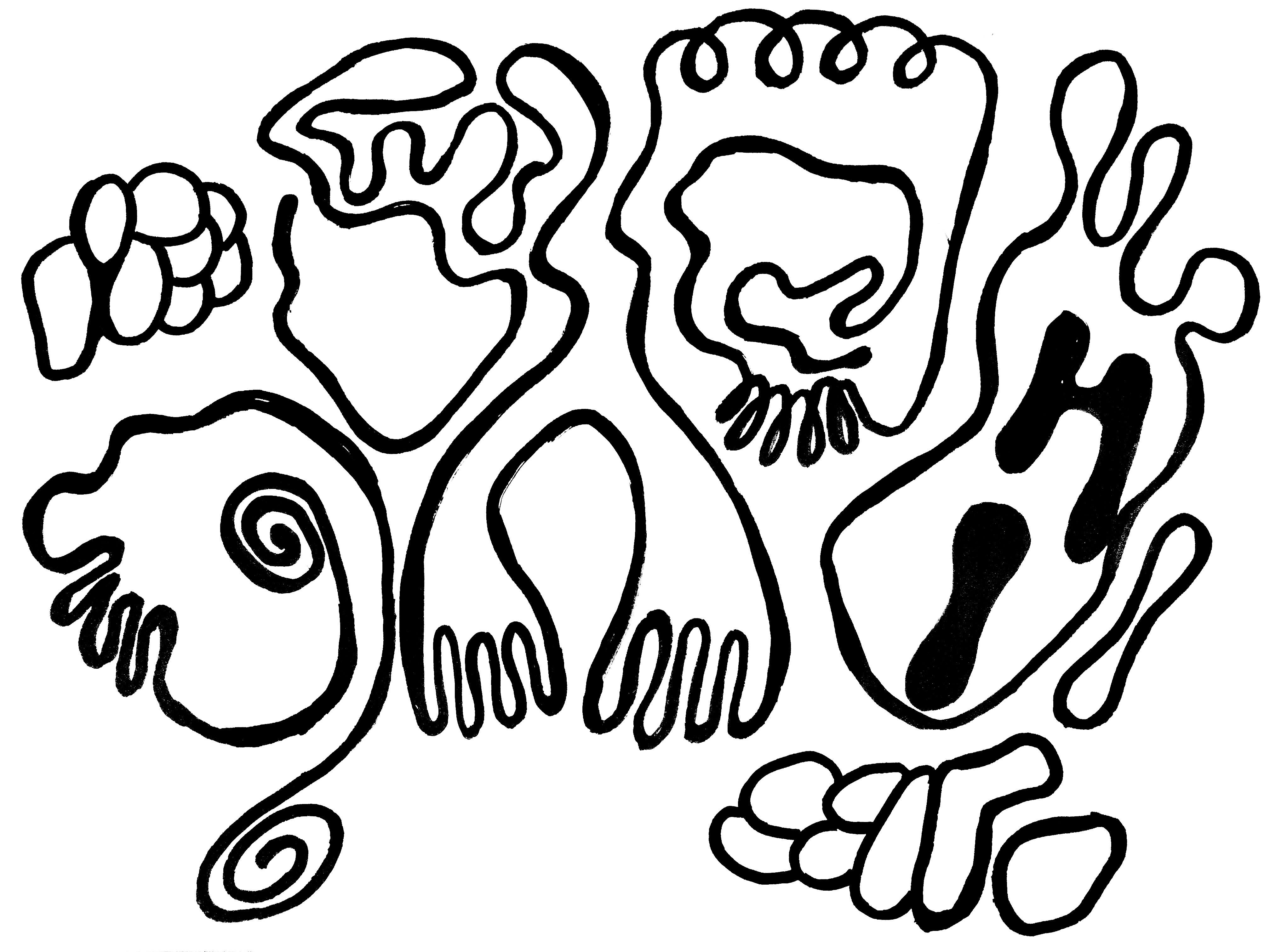
Le constat de l’individualisme n’est plus à faire. Rares sont les discours sur la contemporanéité qui échappent à ce poncif que nous ne connaissons que trop. L’autonomie, l’indépendance, le libéralisme sont présentés comme les fondements et fléaux d’une société - la nôtre (que l’on se plait à nommer par cette formule « nos sociétés occidentales individualistes » par paresse intellectuelle, par abus de langage, et fausse culpabilité postcoloniale) - que nous prétendons condamner et dans laquelle nous nous complaisons tant. Pourquoi, alors, s’intéresser, encore, toujours, à l’individualisme ? Qu’à-t-on à en dire de mieux que : l’égoïsme, c’est mal ? Apparemment pas grand-chose, à en croire le flot d’articles pathologiquement inodores qui circulent à ce sujet. Jusqu’à… Pierre-Henri Castel, qui rend à la pensée ses lettres de noblesses
Pierre-Henri Castel est docteur en philosophie et en psychologie clinique et pathologique, directeur de recherche au CNRS. Il est notamment l’auteur d’une série de deux ouvrages dont La fin des coupables (2012) - qui nous intéresse ici - constitue le deuxième volume. Il est la suite de : Âmes scrupuleuses, vies d'angoisse, tristes obsédés (2011). Il a récemment publié Le Mal qui vient. Essai hâtif sur la fin des temps (2018), dans lequel il quitte ses « lubies » passées, pour interroger, précisément, l’apocalypse à venir. Avant d’envisager l’avenir avec les lunettes de la collapsologie - entendez, les théories de l’effondrement de notre civilisation industrielle sous la pression climatique -, il paraît opportun de comprendre quel présent permet et a permis la fin du futur. Montrer comment les injonctions à l’autonomie, largement encouragée par les progrès scientifiques, participent de la catastrophe à venir est le geste tacite que nous lisons dans La fin des coupables.
Nous soutenir par don unique :
Web page was built with Mobirise