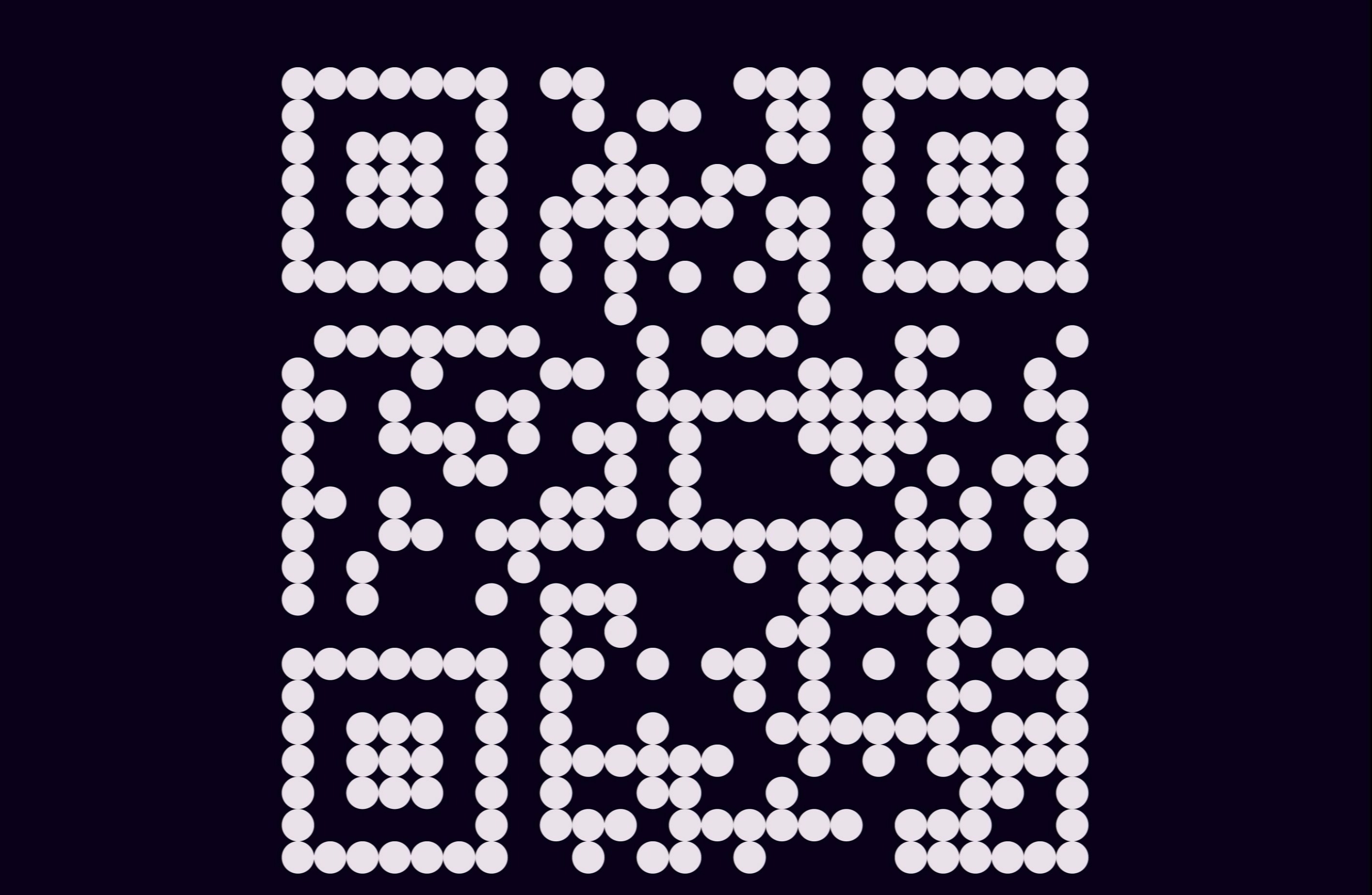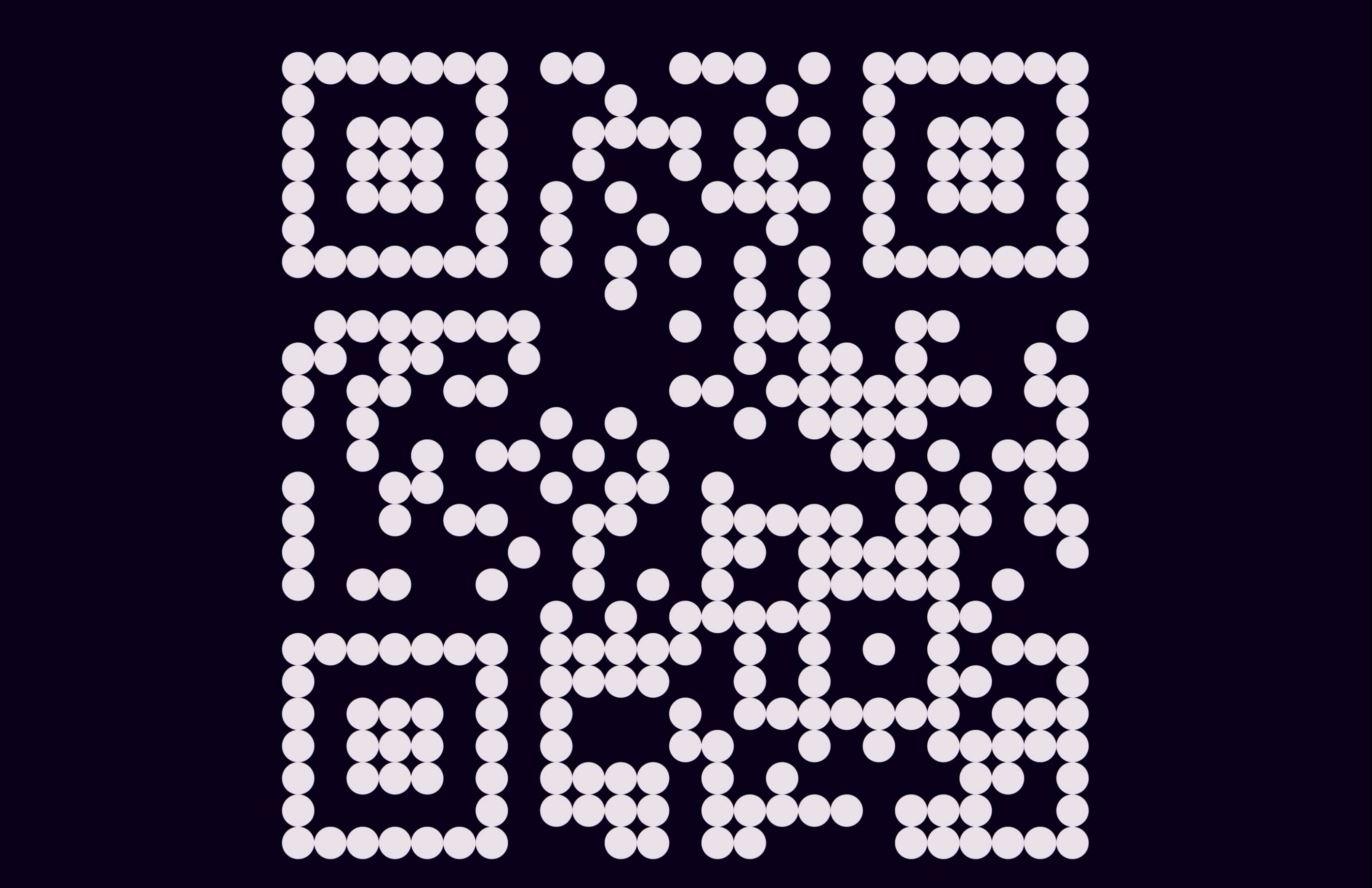C’est-à-dire que les manifestants ne sont pas directement là pour eux, ils ne cherchent pas une augmentation de leurs revenus, une amélioration de leurs conditions de travail..., comme c’est le cas dans les manifestations habituelles, mais ils se mobilisent plutôt dans l’idée de sauver l’humanité, ou plutôt la vie telle que nous la connaissons. C’est le sentiment que l’homo sapiens vivrait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et que son instinct de survie lui indique de se mobiliser pour s’opposer aux attaques faites contre son unique condition d’existence. Concrètement, les personnes se mobilisant n’attendent rien - du moins à court terme et individuellement - de l’engagement qu’ils témoignent. Cela semble de même complètement aller à l’encontre du fonctionnement d’une société où l’individu est la figure suprême et où la possession et la notion de propriété privé semblent être des graals intouchables.
Le néolibéralisme, tel qu’il s’est déployé à partir du tournant des années 1970, a de profondes conséquences sur notre façon d’être humains. Le néolibéralisme met avant tout en avant l’individu, sublimant le moi, y compris dans les émotions. La rhétorique de l'entrepreneuriat, du développement personnel… nous inculque le fait qu’il ne faut rien attendre des autres, rien attendre de l’Etat mais bien plutôt ne compter que sur soi-même pour réussir et être heureux. Pour la sociologue Michèle Lamont, les individus des sociétés néolibérales post-2008 (crise des subprimes) ont fini par croire “qu’il fallait regarder en eux pour se ressaisir”. Doux miracle de l'intériorisation des luttes. Alors que l’on nous dit qu’il ne faut rien attendre des Etats, ces manifestations semblent être un dernier appel, un baroud d’honneur. Comme si, conscients que les Etats ne peuvent, ou plutôt ne font, plus rien, les manifestants en appellent à l’humanité. Non pas à l’Etat en tant qu’entité administrative mais en tant que pouvoir humain. Tel un sursaut.
En fin de compte, on se rapprocherait de la plus pure expression de ce que pourrait être un idéal de l’humanité : des individus qui oeuvrent ensemble pour leur survie future. Ce n’est pas pour moi que je vais manifester, mais pour nous, et pour eux - notamment de la part de ceux qui manifestent tout en sachant qu’ils ne vivront pas ces conséquences dramatiques. Prend le dessus le sentiment que nous avons une histoire et un destin où nous sommes liés, et que l’humanité doit se mobiliser pour assurer sa survie. En quelque sorte, c’est le conatus de l’humanité en tant que sujet qui s’exprime, l’idée définie par Spinoza dans son Ethique que “chaque chose, autant qu’il est en elle, s’efforce de persévérer dans son être”. L’humanité s'efforcerait alors de persévérer dans son être, et les divergences individuelles ne compteraient plus pour beaucoup, loin des traditionnelles manifestations qui clivent habituellement cette haute idée d’humanité. Mais on ne fait que s’en rapprocher car cette cause est encore loin de rassembler tous les semblables, et les individualités ont la peau dure.
En tout cas, pour ce que ces manifestations réunissent, il faut avouer qu’en observant la situation avec un peu plus de recul, la situation a de quoi être absurde. Nous assistons à des scènes, où des individus supplient d’autres individus, d’avoir le droit de continuer à vivre dans le futur. Les individus qui supplient ne veulent pas des choses uniquement pour eux, non, ils se battent pour une idée qui les dépasse, qui dépasse tout le monde, une idée qui risque de mettre en péril toute l’humanité. On a des gens qui pour du pouvoir, pour de l’argent ou pour des intérêts, ont des pratiques qui les menacent eux-mêmes, ainsi que d’autres, ces autres demandent à ces gens de changer de pratiques, mais rien n’y fait. C’est en fin de compte aussi absurde que si des personnes jouaient à la roulette russe avec des gens qui n’ont rien demandé, ces personnes ont à y gagner, les autres non, donc elles les supplient d’arrêter, mais la partie continue et on reste alors plantés-là, dans la peur et dans l’attente du coup de feu.